Mme de Lafayette, 1678
Les études médiévistes ont fleuri dans la recherche universitaire française, pendant l’Occupation. Une façon de s’écarter des questions qui fâchent et se placer à l’abri. Ouvrons donc, dans ces temps purulents, le parapluie rassurant de ce classique du 17e siècle.
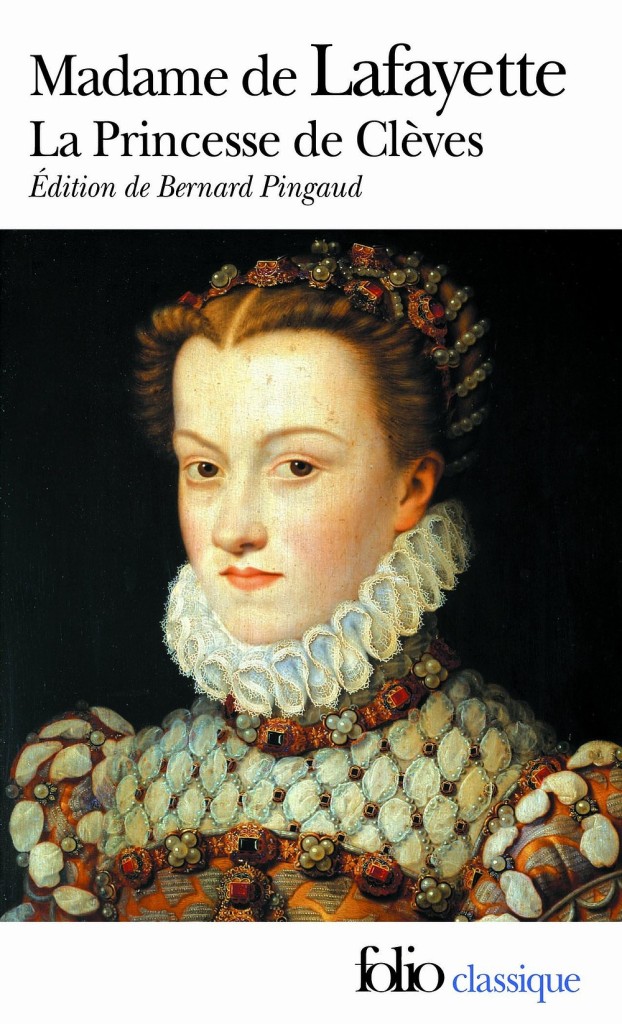
Mme de Lafayette pratique une prudente distanciation historique elle-même en situant son récit quelques générations en arrière. Mais elle parle de son temps, explore les ressorts intimes de cette sublime tension que le dix-septième littéraire ne cessa d’explorer, entre les exigences d’un ordre moral sévère et les puissances de la passion amoureuse. Glissons-nous dans la bulle esthétique de ce chef d’oeuvre, étirons jusqu’à nous la matière universelle de sa beauté.
La société que décrit Mme de Lafayette n’est pas si éloignée de la nôtre. L’individu y vit constamment exposé aux regards, jaugé, moqué, envié ou adulé, contraint de se présenter régulièrement sur la scène des représentations sous peine de mort sociale imminente. Le rythme de la succession des grâces et disgrâces est effréné. Elles se font et se défont sur un mot, une rumeur, un défaut de calcul ou de courtoisie. Dans ce monde le masque social – indispensable et soigneuse construction – vaut identité.
L’intimité semble un refuge inaccessible, où l’extérieur s’immisce. Le lit-même est un endroit social qu’on visite. Où il faut jouer la comédie du malade, si on a cherché là le moyen de se faire porter pâle. C’est dans le secret de son « cabinet » seul que Mme de Clèves trouve le lieu où s’adonner aux émotions interdites. Lieu-soupape où contempler un portrait de l’être aimé, où s’abandonner à soi-même.
Illusoire répit. Car c’est de cet espace protégé, mais ouvert sur le jardin, que Mme de Clèves livre involontairement la partie la plus intime d’elle-même au regard de l’amant qui épie, précipitant le drame. Nul refuge, nulle échappée dans un monde sans angle mort.
Traqués nous-mêmes dans le moindre de nos actes intimes, cernés d’outils intrusifs qui réduisent comme peau de chagrin nos espaces réellement intimes, nous avons le sentiment d’être plus libres que Mme de Clèves quand elle fait ce choix, prisonnière des exigences de son siècle.
Mais cette princesse ne se soumet pas à un ordre moral qui lui serait extérieur. Elle se place au dessus en allant au delà de ses attentes (nul ne lui demande ce sacrifice, ni Dieu ni les hommes). Elle ne se plie pas davantage aux forces volatiles de l’amour. Ni aux usages, ni même à la prudence, en usant avec son mari d’un langage de vérité qu’il ne peut soutenir. Les motivations qu’elle expose sont complexes, mêlées de considérations morales et amoureuses qui peuvent relever pour partie de la coquetterie. On pourrait douter de leur pertinence. Y voir une fuite, une dérobade. Elles habillent un choix fondamental, celui de conquérir cette liberté irréductible, par la possession entière de soi, la maîtrise de son espace intime où nul, pas même l’homme qu’elle aime, ne doit pénétrer.
A la fin du roman, elle peut le prétendre : elle s’appartient.
Mais refermons le parapluie. Et retrouvons le siècle tonitruant.

